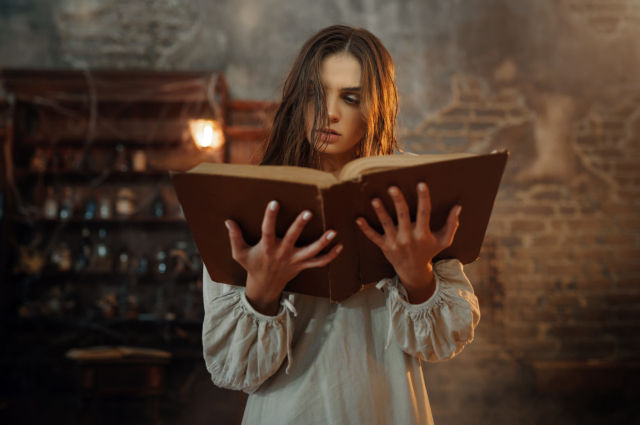Le Pérou est un pays riche en histoire, culture et traditions ancestrales. Les mythes et légendes ont constitué un élément fondamental de l'identité péruvienne au fil des siècles, transmis de génération en génération. Ces histoires, nées de l'imagination et de la sagesse des peuples anciens, révèlent un mélange de croyances religieuses, culturelles et naturelles qui font partie de l'héritage culturel du pays. Certains mythes remontent à l’époque précolombienne, tandis que d’autres ont émergé à l’époque coloniale ou sont le produit de la fusion de diverses cultures.
Dans cet article, nous explorerons quatre des mythes les plus populaires du Pérou, qui continuent de fasciner les Péruviens et les visiteurs pour leur profondeur, leur symbolisme et leur mystère.
Le mythe de Naylamp.
L'un des mythes les plus anciens et les plus significatifs du Pérou précolombien est celui de Naylamp, personnage principal de la légende de la création de la civilisation Lambayeque. Selon le mythe, Naylamp était un demi-dieu arrivé de la mer accompagné de son entourage sur une grande flotte de radeaux, apportant avec lui une culture avancée. Ce héros fondateur aurait établi le premier royaume sur ce qui est aujourd’hui la côte nord du Pérou, dans la région de Lambayeque.
L'arrivée de Naylamp.
La légende raconte que Naylamp, accompagné de son épouse Ceterni et d'une importante délégation de serviteurs et de prêtres, débarqua sur les plages de Lambayeque. Ils apportèrent avec eux des idoles et des objets sacrés qui leur permirent de construire des temples et des villes. La plus importante de ces idoles était Yampallec, une figure divine qui, selon la croyance, garantissait la prospérité et le bien-être du peuple.
Naylamp construisit le grand temple de Chot, où il plaça le dieu Yampallec. Sous son règne, la région prospère et devient un centre culturel et politique important. Le mythe raconte qu'après plusieurs années de règne, Naylamp s'est élevé au ciel, devenant une divinité et laissant un héritage qui durerait pendant des générations.
Importance culturelle.
Ce mythe est le reflet du profond respect que les anciens Lambayecans avaient envers leurs dirigeants et ancêtres. Naylamp symbolise le pouvoir civilisateur et la divinité, car son arrivée a marqué le début d'une nouvelle ère d'organisation et de progrès. De plus, son ascension au ciel en tant que dieu met en évidence la croyance en la continuité de la vie et en la puissance éternelle des fondateurs de la civilisation.
Le mythe de Pachamama et Pachatata.
Le culte de Pachamama, ou Terre Mère, est l’un des mythes les plus représentatifs de la vision andine du monde. Pachamama est une divinité fondamentale pour les cultures préhispaniques, en particulier chez les Incas, qui la vénéraient comme la protectrice de la nature, des cultures et de la fertilité. Sur l'île d'Amantaní, située dans le lac Titicaca, se développe une version particulière de ce mythe, impliquant non seulement la Pachamama, mais aussi son homologue masculin, la Pachatata.
La dualité entre Pachamama et Pachatata.
Le mythe de Pachamama et Pachatata reflète la dualité andine de l'équilibre entre masculin et féminin, ciel et terre, production et protection. Selon la tradition, Pachamama représente la terre fertile et abondante, tandis que Pachatata est la force masculine qui gouverne les cieux et les montagnes.
Sur l'île d'Amantani, des cérémonies ont lieu chaque année pour remercier les deux divinités. Les habitants gravissent les collines sacrées, où se trouvent les temples dédiés à Pachamama et Pachatata, pour faire des offrandes et demander de bonnes récoltes et une protection. Cette cérémonie est un exemple de la façon dont la culture andine a maintenu vivantes ses croyances ancestrales, respectant l'équilibre entre les éléments de la nature.
Importance culturelle.
La relation entre Pachamama et Pachatata est une représentation du lien profond que les peuples andins entretiennent avec leur environnement naturel. Le respect de la terre et du cosmos est au cœur de leur vision du monde, et le mythe nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec la nature pour assurer la prospérité et la survie des générations futures.
Le mythe d'Amaru.
L'Amaru est un serpent mythologique présent dans plusieurs cultures pré-incas et incas, comme le Tiahuanaco et les Incas. Cet être surnaturel est considéré comme une divinité liée à la fertilité, à l'eau et aux cycles de la vie. Dans l'iconographie andine, l'Amaru est généralement représenté comme un grand serpent capable de voler et de se déplacer entre les mondes souterrain et céleste.
Le mythe d'Amaru.
Selon le mythe, l'Amaru vit dans les profondeurs de la terre, dans les lacs ou dans les montagnes, et aurait la capacité de provoquer des pluies torrentielles ou des sécheresses, selon son humeur. On dit que lorsque les humains ne respectent pas la nature, l’Amaru se met en colère et provoque des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des tempêtes.
D’un autre côté, s’il est correctement honoré, l’Amaru apporte abondance, fertilité et prospérité aux terres. Dans certains mythes, l'Amaru apparaît comme un être bienfaisant qui aide les agriculteurs à cultiver leurs terres et à obtenir de bonnes récoltes.
Importance culturelle.
Le mythe d'Amaru souligne la croyance andine dans le pouvoir de la nature et l'importance de la respecter. L'Amaru n'est pas simplement un monstre, mais une manifestation de forces naturelles qui, si elles sont respectées et honorées, garantissent la survie de la communauté. Cette croyance en Amaru continue de vivre dans certaines régions des Andes, où des rituels sont organisés pour apaiser les esprits de la terre et de l'eau.
La légende de la Maison Matusita.
Au cœur de Lima, la Casa Matusita est connue comme l'une des maisons les plus hantées du Pérou. Sa renommée a transcendé les frontières du pays et a généré une série de mythes et de légendes autour des événements mystérieux qui se dérouleraient entre ses murs.
Le mythe de la Casa Matusita.
Selon la légende, la maison a été le théâtre d'un meurtre violent dans le passé, lorsqu'un homme, après avoir découvert que sa femme le trompait, est devenu fou et a assassiné toutes les personnes présentes lors d'un dîner. Depuis, on raconte que les esprits des morts errent dans la maison, provoquant des phénomènes paranormaux.
Une autre version du mythe prétend qu'à l'époque coloniale, la maison était le lieu de réunions secrètes de personnages sombres et de sectes qui pratiquaient la magie noire, ce qui aurait laissé une énergie maléfique dans les lieux.
On raconte que ceux qui ont tenté de passer la nuit au deuxième étage de la maison en sont sortis bouleversés ou ont subi des morts étranges. Malgré les efforts visant à nier ces histoires, la légende de la Casa Matusita reste vivante et de nombreux habitants de Lima préfèrent ne pas s'approcher des lieux une fois la nuit tombée.
Importance culturelle.
Ce mythe urbain reflète l'intérêt pour le surnaturel dans la culture populaire péruvienne. Les histoires de fantômes, de maisons hantées et de malédictions sont courantes dans l’imaginaire collectif de nombreuses villes d’Amérique latine, et Casa Matusita est un exemple clair de la façon dont les légendes urbaines peuvent perdurer au fil du temps.
Les mythes et légendes du Pérou sont une fenêtre sur la vision du monde des anciens habitants du pays et sur les croyances populaires qui sont restées vivantes au fil des siècles. Des histoires comme celle de Naylamp, Pachamama et Pachatata, l'Amaru et la Casa Matusita montrent à quel point le mythe est étroitement lié à la nature, à la culture et à la vie quotidienne des Péruviens. Ces histoires font non seulement partie du patrimoine culturel du Pérou, mais reflètent également les liens profonds entre les êtres humains, leur environnement et les mystères de l'univers.